La blockchain au service des droits d’auteur : décision clé
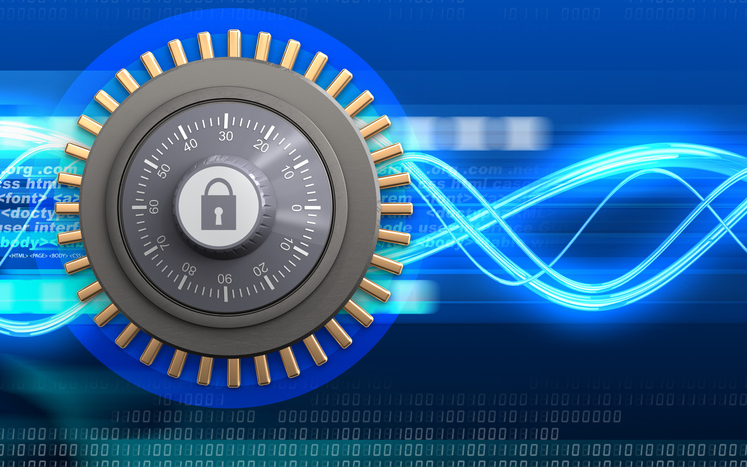
Publié le 2025-04-21
Créer, c’est affirmer un style, un message, une vision.
Mais encore faut-il que le droit reconnaisse cette originalité.
Et si vous pouviez aujourd’hui dater, tracer et protéger vos œuvres comme on verrouille un coffre-fort ? Grâce à la blockchain, une nouvelle génération de preuve devient possible.
Une décision pionnière du Tribunal judiciaire de Marseille l’illustre parfaitement. Voici comment faire de la traçabilité un levier de souveraineté créative.
Sommaire
1)Introduction
2) Cibler les enjeux de la décision du 20 Mars 2025
2-a ) explications juridiques
2-b) Explication technique de la preuve par horodatage : une précision trop souvent négligée
2-c) le Hash du certificat d'horodatage doit toujours être « vérifié »
2-d) L’autre perspective de raisonnement du tribunal la recherche des éléments de preuve de l’originalité des vêtements de mode copiés
2-e) La preuve de l’originalité : l’angle mort de la protection par le droit d’auteur
3) Originalité, traçabilité, opposabilité du parcours créatif: le raisonnement inédit du tribunal de Marseille
3.1)Premier élément vérifié : la matérialité de l’effort créatif
3.2) Deuxième élément : la qualité du support et la cohérence esthétique
3.3)Troisième élément : l’articulation avec les droits connexes
4) Créer, tracer, prouver : l’horodatage comme levier de sécurisation
4-1) Le certificat d’horodatage : un levier stratégique pour protéger vos innovations
4-2) Un certificat de preuve universel et interopérable
4-3) Une protection qui se prépare, elle ne s’improvise pas
4-4) À l’heure de l’IA générative : une exigence encore renforcée
4-5) Mon offre de services : de l’outil à l’accompagnement stratégique
1)Introduction
Une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille, le 20 mars 2025 (RG n° 23/00046), a suscité de nombreux commentaires dans un litige portant sur la contrefaçon de vêtements de mode protégés par des droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et des marques.
Ce jugement a validé explicitement la production, par la société créatrice des modèles copiés, d’un certificat d’horodatage sur blockchain.
Cet horodatage avait pour but :
- de prouver l’antériorité d’existence des modèles concernés,
- mais surtout de démontrer leur originalité, condition indispensable pour faire reconnaître la protection par le droit d’auteur.
Le tribunal a reconnu que l’empreinte numérique, immuable et unique, associée à chaque fichier de création des modèles copiés, et détaillant le parcours créatif , vérifiée avec le contenu des fichiers originaux, constituait une preuve recevable contre l’entreprise contrefaisante.
L’apport fondamental de cette décision ,sans doute appelée à faire jurisprudence ,ne réside pas uniquement dans la reconnaissance de la validité du protocole blockchain comme procédé mathématique d’aide à la preuve en matière de contrefaçon.
Il réside surtout dans l’analyse juridique rigoureuse menée par les juges, qui ont examiné comment la technologie de l’horodatage pouvait être urilisée, en droit d’auteur, à la démonstration de l’originalité, de l’antériorité et de l’opposabilité de ces droits.
Comprendre ce jugement, c’est aussi comprendre comment organiser et documenter une stratégie de traçabilité créative à l’ère du numérique.
L’horodatage par technologie blockchain n’est pas une solution magique :
- Il n’acquiert de force probatoire qu’à la condition de s’inscrire dans une démarche rigoureuse et structurée de constitution de la preuve, ici celle des droits d’auteur revendiqués par la société AZ Factory.
C’est précisément sur ce point que le jugement du 20 mars 2025 apporte un éclairage précieux.
Il constitue une décision claire et pédagogique, à destination notamment des créateurs, entreprises innovantes, studios de design, agences de communication ou UX designers, en quête de solutions pour protéger ce qu’ils possèdent de plus stratégique :
- leurs actifs incorporels, c’est-à-dire leurs droits de propriété intellectuelle, fruit d’un effort créatif ou d’un savoir-faire différenciant.
C’est tout l’objet de l’article que nous vous proposons.
2) Cibler les enjeux de la décision du 20 Mars 2025
2-a ) explications juridiques
Cette affaire concernait, en demande, la société AZ FACTORY, créatrice des vêtements originaux et iconiques intitulés « Hearts from X » et « Love from X ».
(nous avons choisi de conserver l’anonymisation du nom du créateur, conformément aux principes de l’open data judiciaire).
La société AZ FACTORY avait assigné pour contrefaçon la société VALERIA MODA, accusée d’avoir commercialisé des copies serviles de ses créations.
Malgré l’annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon pour vice de procédure :
- Le tribunal a jugé que VALERIA MODA s’était bien rendue coupable d’actes de contrefaçon.
Elle avait reproduit des vêtements identiques aux modèles originaux, mais fabriqués dans une qualité de tissu nettement inférieure, et vendus à bas prix banalisant ainsi l’originalité et la valeur patrimoniale des créations protégées.
La preuve de la contrefaçon a été juridiquement admise grâce à la production :
- de deux certificats d’horodatage blockchain, datés des 5 mai 2021 et 15 septembre 2021, attestant que les fichiers de création des vêtements avaient bien été enregistrés à ces dates ;
et
- d’un constat d’huissier, dressé le 19 octobre 2022, venant « vérifier» que les fichiers source conservés par AZ FACTORY correspondaient exactement aux empreintes numériques inscrites dans les certificats d’horodatage.
2-b) Explication technique de la preuve par horodatage : une précision trop souvent négligée
Le certificat d’horodatage ne prouve pas, en lui-même, le « contenu de l’œuvre ».
Ce n’est d’ailleurs pas sur ce point que le Tribunal judiciaire de Marseille a fondé son raisonnement.
L’intérêt majeur du jugement réside dans la reconnaissance explicite, par le tribunal, de la valeur probante du processus d’horodatage comme élément recevable au débat judiciaire.
En d’autres termes, la juridiction a admis qu’étaient valablement prouvés :
- l’existence d’un fichier contenant des informations numériques,
- son identification par une empreinte (hash) immuable,
- et l’ancrage de cette empreinte dans une blockchain, garantissant une date certaine et une existence matérielle vérifiable.
Mais pour que le certificat d’horodatage devienne juridiquement opérant dans un débat judiciaire, il doit être corrélé à une vérification précise.
Il appartient à la personne qui a procédé à l’horodatage de prouver que le fichier source qu’elle produit en justice est bien celui dont l’empreinte numérique a été inscrite dans le certificat.
C’est par ce niveau de concordance que le certificat d’horodatage joue réellement son rôle « d’aide à la preuve » :
- en garantissant l’intégrité des données,
- en fixant leur date d’existence certaine,
- et en établissant un lien entre contenu horodaté et preuve présentée.
En pratique, cette mécanique repose toujours sur un prestataire de services spécialisés qui :
- génère l’empreinte cryptographique du fichier (le hash),
- l’ancre dans une blockchain (publique ou privée),
- et met à disposition une interface de vérification,
- permettant de comparer le hash d’un fichier produit avec celui inscrit dans le certificat.
2-c) le Hash du certificat d'horodatage doit toujours être « vérifié »
Dans l’affaire commentée, le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que cette vérification technique avait bien été réalisée. Il relève ainsi dans sa décision que :
- « L’empreinte digitale des dessins y afférents avait fait l’objet d’un ancrage dans la blockchain par la solution Blockchainyour IP le 05/05/2021, constaté par huissier le 19/10/2022. »
La mention « constaté par huissier » signifie ici que le professionnel mandaté a procédé à la comparaison du hash du fichier source avec celui inscrit dans le certificat d’horodatage, selon le mécanisme du hachage cryptographique.
Si les deux empreintes numériques sont identiques, la correspondance entre le fichier produit et le certificat est juridiquement établie.
Autrement dit, la preuve est parfaite, car le contenu des droits opposés est considéré comme « intègre »avec le bénéfice d’antériorité d’existence à la date d’ancrage dans la blockchain.
Le tribunal en tire une conclusion claire :
- La société AZ Factory a ainsi apporté une preuve tangible et infalsifiable de la date de création »
- et a démontré la démarche authentiquement créative de son auteur.
Ce raisonnement illustre que le certificat d’horodatage ne vaut preuve que s’il est lié à un fichier source identifiable et vérifiable.
Et c’est bien l’ensemble des informations contenues dans le fichier source :
- croquis,
- dessins,
- documentation du processus créatif,
qui, une fois intégralement horodatées et validées par comparaison, confèrent à la démarche d’horodatage sa force juridique.
2-d) L’autre perspective de raisonnement du tribunal la recherche des éléments de preuve de l’originalité des vêtements de mode copiés
Il est désormais essentiel de replacer la décision du tribunal dans une autre perspective, aussi déterminante que le recours à la technologie blockchain :
- celle de la qualification juridique de l’œuvre comme “originale”.
En matière de droit d’auteur, on oublie trop souvent que lorsqu’un créateur souhaite exercer ses droits patrimoniaux ou défendre son monopole d’exploitation, il se heurte à une exigence qu’il n’a pas toujours anticipée :
- Prouver que son œuvre est protégeable.
Autrement dit, il ne suffit pas de se dire « auteur » pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Encore faut-il démontrer que l’œuvre remplit une condition sine qua non :
- son originalité.
Et c’est bien souvent lors d’un litige, au moment où un tiers commence à reproduire ou exploiter l’œuvre fût-ce partiellement, par imitation de certains éléments clés, que cette exigence probatoire surgit brutalement.
L’auteur, persuadé que le simple fait d’avoir créé suffisait à garantir ses droits, découvre alors que :
- C’est à lui seul qu’il appartient de démontrer qu’il peut légitimement privatiser l’exploitation de l’œuvre.
Ce qui paraît évident dans l’esprit du créateur :
- « Cette œuvre est de moi, donc elle est originale ! »
Devient, en droit une question de démonstration.
Et pour paraphraser Rainer Maria Rilke, qui rappelait que dans la vie « tout est travail »,
il faut bien admettre que :
- Même la preuve de l’originalité en est un !
C’est souvent à cet instant d’effroi, presque injuste, que l’auteur réalise ; parfois trop tard ;qu’il aurait dû conserver les traces de son parcours créatif pour pouvoir défendre les droits patrimoniaux attachés à sa création.
Car être original n’est pas un « état déclaratoire ».
Il faut encore savoir en faire la preuve.
Et cette démonstration est, elle aussi, un art.
2-e) La preuve de l’originalité : l’angle mort de la protection par le droit d’auteur
Pour tout juriste spécialisé en propriété intellectuelle, la preuve de l’originalité constitue sans doute l’un des sujets les plus complexes et les plus déconcertants lorsqu’il s’agit de faire reconnaître la protection d’une œuvre par le droit d’auteur.
Si l’originalité a toujours été consubstantielle au droit d’auteur, son traitement juridique a profondément évolué.
À l’origine, il suffisait d’identifier si l’œuvre relevait d’une catégorie protégée pour en déduire qu’elle était éligible à la protection.
L’originalité était donc une question de « qualification ».
Mais au fil du temps et notamment avec l’industrialisation, la numérisation, et l’essor de créations utilitaires ou techniques, la question s’est déplacée sur un autre terrain :
- celui de la preuve.
Nombre de créateurs revendiquent aujourd’hui la protection du droit d’auteur pour des objets ou contenus de plus en plus éloignés des arts classiques (peinture, musique, littérature).
En réponse, les juridictions nationales et européennes ont renforcé leur exigence :
- il ne suffit plus de créer, encore faut-il démontrer que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Ce basculement probatoire crée une zone d’incertitude majeure, pour les créateurs qui doivent apporter les justifications suivantes :
- Quand l’œuvre a-t-elle été créée ?
- Démontrer qu’elle est le fruit d’un effort créatif personnel, et non une simple exécution fonctionnelle ou décorative ?
- Donc comment prouver ces 2 éléments de façon juridiquement recevable ?
Deux défis majeurs sont alors apparus :
Le premier est celui de l’antériorité d’existence dans le temps :
- Le créateur doit démontrer que son œuvre existait avant celle de son imitateur.
- À l’ère numérique, où tout peut être copié et diffusé en quelques secondes, justifier de la date certaine de création ou de divulgation constitue un enjeu stratégique majeur.
Le second, plus complexe encore, est celui de l’implication personnelle et de la démonstration de la créativité :
La jurisprudence exige désormais que l’auteur puisse prouver « en quoi » et « comment » il a exprimé sa « personnalité » dans la réalisation de son œuvre.
Cette exigence est d’autant plus forte aujourd’hui à l’heure des outils d’intelligence artificielle générative, qui brouillent la frontière entre création humaine et production assistée par la machine.
Concrètement, cela suppose pour le créateur de reconstituer son parcours créatif :
- Croquis, esquisses, versions successives, choix techniques ou esthétiques.
Tous ces éléments permettent de montrer que l’œuvre n’est pas simplement « apparue », mais qu’elle a été construite par une démarche originale.
Depuis les années 2000, cette exigence probatoire a été solidement ancrée dans la jurisprudence de la Cour de cassation française, notamment à travers trois arrêts fondamentaux :
-
Chambre commerciale, 28 janvier 2003 (n° 00-10.657)
L’originalité suppose que l’œuvre présente un caractère distinct, dissociable de sa fonction technique ou utilitaire, révélant clairement la personnalité de son auteur.
-
Chambre criminelle, 4 novembre 2008 (n° 08-81.955)
Les auteurs doivent prouver précisément “si et en quoi” chaque œuvre revendiquée résulte d’un effort créatif personnel portant l’empreinte de leur personnalité.
-
Chambre criminelle, 30 juin 2009 (n° 08-83.060)
En matière de contrefaçon, il revient au juge d’examiner attentivement et individuellement chaque œuvre pour vérifier si l’effort créatif de l’auteur y est manifestement exprimé.
Seule cette empreinte personnelle permet de qualifier l’œuvre comme originale et de la faire entrer dans le champ du droit d’auteur.
Ainsi, aujourd’hui, la démonstration rigoureuse de l’effort créatif et de l’empreinte personnelle est une exigence constante, quelle que soit la nature de l’œuvre (graphique, sonore, littéraire, design, publicitaire, etc.), et ce particulièrement lorsqu’un contentieux oppose un auteur à un tiers contrefacteur.
3) Originalité, traçabilité, opposabilité du parcours créatif: le raisonnement inédit du tribunal de Marseille
Le Tribunal a appliqué avec rigueur les principes désormais bien établis en jurisprudence sur la preuve de l’originalité des œuvres revendiquées à la protection au titre du droit d’auteur.
Ce qui rend cette décision remarquable, c’est la manière dont la société AZ FACTORY avait documenté sa démarche créative, en produisant des fichiers horodatés retraçant de manière précise et datée l’ensemble du parcours de création.
Grâce à ce faisceau probatoire rare, cohérent et antérieur, les juges ont pu constater que l’originalité des modèles copiés n’était pas simplement alléguée, mais bel et bien :
- Traçable,
- Datée,
- Opposable,
3.1)Premier élément vérifié : la matérialité de l’effort créatif
La société AZ FACTORY avait horodaté des fichiers illustrant, étape par étape, la genèse des deux modèles concernés.
Pour la ligne “Love from X” :
Les fichiers contenaient des croquis personnels du créateur, se représentant lui-même sous une forme stylisée proche du cartoon ou de l’illustration narrative ;
- Ces dessins, porteurs de messages d’amour, étaient intégrés dans les vêtements à la manière d’encarts de bande dessinée.
Pour la ligne “Hearts from X” :
- Les fichiers déposés montraient des cœurs multiples, de tailles et coloris variés.
- Dans les deux cas, l’originalité provenait d’une combinaison graphique, symbolique et stylistique, échappant à toute contrainte fonctionnelle.
- Le tribunal a expressément relevé la liberté, le caractère arbitraire, et la fantaisie certaine de ces choix créatifs.
3.2) Deuxième élément : la qualité du support et la cohérence esthétique
Les 2 créations étaient conçues pour être imprimées sur des chemises et pantalons en soie.
- La qualité du support textile, explicitement mentionnée comme élément de création dans les fichiers horodatés, contribuait pleinement à l’identité visuelle et sensorielle de la collection.
- L’œuvre, ici, ne réside pas uniquement dans le motif graphique, mais dans l’alliance créative entre forme, fond et matière, soigneusement mise en œuvre et traçable.
3.3)Troisième élément : l’articulation avec les droits connexes
AZ FACTORY n’a pas seulement démontré un effort créatif : elle avait également organisé la protection et la diffusion de ses œuvres.
Elle avait notamment :
- Déposé des marques correspondant au nom des collections, renforçant l'identité commerciale des modèles ;
- Documenté la date de première divulgation des créations via des publications sur YouTube et Instagram, dès mars 2021.
Cette triple articulation :
- Originalité,
- Traçabilité technique,
- Diffusion publique identifiable,
a permis au tribunal de reconnaître aux certificats d’horodatage une valeur juridique pleine, non pas en tant que simples documents techniques :
- Mais parce que les éléments horodatés étaient vérifiables, datés et explicables, ils ont pu s’insérer dans un raisonnement juridique structuré, lui donnant toute sa force probatoire.
4) Créer, tracer, prouver : l’horodatage comme levier de sécurisation
Ce que révèle la décision du Tribunal judiciaire de Marseille, ce n’est pas simplement que l’on peut horodater une œuvre grâce à la blockchain.
Une telle lecture serait réductrice.
L'apport majeur et subtil de cette décision est d’avoir reconnu le certificat d'horodatage comme une aide à la preuve recevable et opposable, notamment dans le cadre d’un contentieux en contrefaçon de droit d’auteur.
Ce n’est donc pas la technologie d’horodatage en elle-même qui crée la valeur juridique, mais bien la manière dont elle s’intègre dans une démarche rigoureuse de documentation, de structuration et de traçabilité du processus créatif.
4-1) Le certificat d’horodatage : un levier stratégique pour protéger vos innovations
Utilisé en amont, l’horodatage permet de documenter chaque étape du processus créatif, bien avant qu’une finalité commerciale ou un litige n’émerge.
Il s’inscrit dans le tempo des nouvelles pratiques numériques et de l’économie fondée sur l’innovation.
🎨 Artistes,
📐 designers,
🧠 UX specialists,
💡 publicitaires,
🎮 studios de jeux,
🔬 chercheurs, start-ups, ou entreprises détenant des savoir-faire stratégiques ou des secrets d’affaires :
- tous peuvent bénéficier de cette technologie pour protéger, sécuriser et valoriser leurs actifs incorporels.
4-2) Un certificat de preuve universel et interopérable
La reconnaissance judiciaire du certificat d’horodatage blockchain présente également un avantage transnational majeur.
Reposant sur un protocole mathématique ouvert, l’empreinte (hash) générée a une valeur probatoire universelle, indépendamment des spécificités des systèmes juridiques nationaux.
💡 Le hash, preuve mathématique de l’intégrité et de l’antériorité, constitue un langage universel du code, juridiquement opposable devant toutes les juridictions, quels que soient les systèmes de droit.
4-3) Une protection qui se prépare, elle ne s’improvise pas
L’analyse du jugement le démontre clairement que:
pour rendre l’horodatage juridiquement opérant, il faut maîtriser toutes les conditions juridiques, techniques et stratégiques qui en garantissent la recevabilité.
Cela inclut notamment :
- La titularité des droits sur l’œuvre ;
- Le lien personnel et créatif avec le parcours de création ;
- La cohérence du format de fichier et de sa structure interne ;
- La qualité des métadonnées et leur indexation ;
- Le moment pertinent de l’ancrage ;
- Et l’articulation avec d’autres preuves (divulgation publique, marques, dépôts de modèles...).
Il ne suffit donc pas de cliquer sur « horodater » pour être protégé.
Il faut concevoir un parcours probatoire cohérent, juridiquement valide, et anticiper chaque usage futur de la preuve.
4-4) À l’heure de l’IA générative : une exigence encore renforcée
Ce besoin de structuration s’intensifie avec l’essor de l’intelligence artificielle générative, devenue omniprésente.
Parmi les nouveaux défis :
Distinguer ce qui relève de la création humaine et ce qui est généré automatiquement ;
Prouver que l’empreinte personnelle de l’auteur reste identifiable dans le contenu final ;
Anticiper la tokenisation et la gestion patrimoniale des droits de propriété intellectuelle hybrides.
Cela implique de nouvelles bonnes pratiques :
- Une traçabilité fine et continue des contributions humaines ;
- Des mentions claires dans les CGU (Conditions Générales d’Utilisation) sur les modalités d’usage de l’IA, leur autonomie, leur finalité ;
Et une information transparente, comme l’exige le futur IA Act européen, sur la nature des contenus générés ou assistés par l’Intelligence Artificielle..
4-5) Mon offre de services : de l’outil à l’accompagnement stratégique
Maître Véronique Rondeau-Abouly, avocate et certifiée en technologies blockchain, vous accompagne dans la constitution, la documentation et la valorisation de vos actifs immatériels à travers l’horodatage.
Un service sécurisé d’horodatage sur la blockchain Tezos est accessible directement depuis mon site, rubrique « Services ».
- Il est conçu pour accompagner :
- les créateurs,
- les entreprises innovantes,
- les designers et communicants,
- les start-ups,
- et toutes les structures soucieuses de protéger leurs fichiers sensibles, créations originales, ou savoir-faire.
Mais mon accompagnement va bien au-delà de la technologie :
je vous aide à :
- structurer votre démarche juridique,
- organiser vos fichiers numériques en vue de leur preuve d’originalité,
- et préparer la valorisation future de vos œuvres (dépôt, commercialisation, tokenisation, ou encore due diligence sur l’opposabilité de vos droits de propriété intellectuelle en amont d’une cession ou d’une opération sur titres).
Vous voulez protéger ce que vous créez ? Parlons en
Je vous accompagne pour bâtir une stratégie juridique personnalisée, adaptée à vos outils, vos usages, et votre vision.
Et parce que l’innovation ne s’arrête jamais, d’autres articles paraîtront prochainement sur ce site pour approfondir :
- Les enjeux de preuve à l’ère de l’IA générative et des LLM ;
Et la normalisation juridique désormais obligatoire pour l’utilisation des systèmes de fondation (GPAI), telle que prévue aux articles 51 à 56 du règlement européen sur l’intelligence artificielle.
Cet article a été rédigé par Maître Véronique Rondeau Abouly, avec l’appui de l’IA d’OpenAI pour la relecture et l’optimisation du contenu.
Les idées, analyses et arguments développés reposent exclusivement sur l’expertise de l’auteure, l’outil IA ayant été utilisé pour renforcer la clarté et la précision du texte.
Article publié le 21 Avril 2025
Véronique RONDEAU-ABOULY
Avocat Blockchain et DPO externe
Crédits photos iStock by Getty images :
Texte Audio by : SpeechGen.io - ai Text to speech
Mots clefs: droit d'auteur- blockchain- preuve numérique- horodatage blockchain-propriété intellectuelle originalité contrefaçon-intelligence artificielle générative preuve d'antériorité-actifs incorporels tokenisation- secrets d'affaires-savoir-faire




